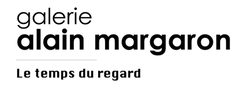Un graal enfoui

L’héritage culturel de Godeg a rencontré l’histoire de son temps. Déjà en 1917, mobilisé, il donne à Verdun la forme d’une église en ruine. En 1929, la chape de plomb du nazisme prend la forme d’un paysage noir au fusain, auquel feront écho certains Goldbilder, trente trois ans plus tard.
Jusqu’en 1945, il a parsemé son œuvre figurative de petits formats à l’atmosphère lourde, comme dans les films d’Hitchcock, celle de la peur qui suintait à l’époque, y compris dans les rues de Paris où il fut enrôlé comme dessinateur de guerre pendant l’occupation.
Après un passage par un surréalisme tardif, puisqu’interdit sous Hitler, mais nécessaire et souvent angoissé, il a confronté, de 1957 à 1965, noir et lumière, forces du mal et beauté, énergie, vitalité, fertilité et disparition ; fait surgir des squelettes, des revenants de la splendeur de l’or ; provoqué un sentiment de culpabilité tout en évoquant L’or du Rhin. Ses œuvres sont à multiples lectures comme celles de Zoran Music.
Godeg se campe en penseur visionnaire dans ses autoportraits et recouvre ses peintures d’or d’entrelacs qui peuvent suggérer une écriture. Des caractères ésotériques mettent parfois, plus explicitement, sur la piste d’un Graal enfoui, de ce qui peut rester des richesses du romantisme et de la mythologie de l’Allemagne après la guerre, avec une puissance wagnérienne. Il souligne que son œuvre a du sens, un contenu riche et complexe, mais veut nous le faire découvrir par nous-mêmes, sans explication, nous faire dire, pas dire. Il multiplie les formes énigmatiques.
C’était essentiel pour sauver la peinture du naufrage d’une culture européenne qui n’avait pu s’opposer à Auschwitz.
La peinture ne joue son rôle sans équivalent pour accroître notre capacité de penser par nous-mêmes, décanter nos désirs, nous réapproprier notre imagination, nous recentrer sur des questionnements essentiels qu’à la condition que nous soyons particulièrement éveillés et actifs pour capter ce qu’elle suggère, avec nos propres mots, en nous appropriant notre culture littéraire et philosophique.
Trop de modes d’emploi délivrés par des artistes pour comprendre leurs œuvres sont réducteurs et amputent celles-ci des richesses de la polysémie.
Voudrait-il tout expliquer d’ailleurs, un peintre le pourrait-il ? Souvent les œuvres se créent en se faisant, elles révèlent l’artiste à lui-même, comme elles révèlent ensuite ceux qui regardent à eux-mêmes, et à de nouvelles pensées, et les incitent à partager.
A.M.