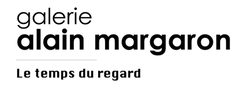Le silence n’existe pas

Tout au long des années 1960, la pratique de René Laubiès évolue sans à coup, et avec certitude, vers un dépouillement toujours plus extrême, jusqu’à disparition complète du signe – celui-ci, malgré son abstraction, renvoyant encore à quelque chose, qu’il s’agisse d’un motif anecdotique ou incantatoire, d’une écriture musicale ou poétique. Tout se passe comme si Laubiès, épris de méditation et adepte du taoïsme, tentait dans son œuvre de s’éloigner de la surcharge ou du détail pour au contraire simplifier, épurer, aller à l’essentiel. Non pas représenter mais sonder son modèle pour en extraire la substantifique moelle. (…)
Dans cette recherche, peu à peu, la palette se réduit, tend vers la monochromie; la peinture se liquéfie et s’arrache à la matière pour ne plus advenir que par les effets de colorations, les vibrations, les nuances et les conversations lumineuses des tons.
Chaque trait, aussi infime soit-il, chaque touche, aussi discrète soit-elle, fait sens et entre finement en résonance. Ce n’est pas par l’accumulation mais par le retranchement, non par leur apparition que dans leur effacement, que les couleurs sont posées avec délicatesse et parcimonie. La peinture de Laubiés tend à la disparition. Elle flirte assurément avec le vide pour en révéler l’insoupçonnable richesse. «Le silence n’existe pas», nous a enseigné John Cage qui y eut recours comme un moyen d’intensifier l’écoute. Ainsi en va-t-il également des œuvres épurées de René Laubiés qui emploient «le mot juste… rien de moins», selon l’expression de William Lowler, soit une ou deux valeurs dominantes, un accent, une inflexion ou quelques notations colorées dont la subtile alchimie s’offre à qui prend le temps de poser son regard sur la page, de s’arrêter pour contempler et se laisser emporter.
Les peintures de Laubiès ont souvent été rapportées au genre du paysage, dans une filiation artistique qui s’appuie sur les dernières œuvres de William Turner et les Nymphéas de Claude Monet, véritablement redécouverts après la guerre. Elle ouvre sur un paysagisme abstrait qui ne se limite plus à la transcription des apparences mais vise à la transposition directe sur la toile de rythmes ou d’émotions. «Rapide et lente, cette peinture est l’art d’un instant dilaté indéfiniment suspendu» écrivait ainsi le critique Julien Alvard ardent défenseur d’un art qui ne recompose pas la nature mais s’en laisse pénétrer.
Car l’œuvre de Laubies, si elle saisit un instant, le rend intemporel si elle se souvient d’un lieu, n’en permet pas la reconnaissance. Pas de repères fixes ni concrets dans ces œuvres éthérées, mais un continuum fluide et mouvant qui procède des puissantes rêveries de Gaston Bachelard. «Ces paysages sont des nus, des nus de la rêverie» songeait encore André Berne-Joffroy. Car chaque oeuvre, en fin de compte, dans sa retenue même, porte en elle un monde en soi, comme un petit morceau d’infini, n’invitant plus à voir le monde mais à l’éprouver et à en saisir les plus infimes palpitations.
Ainsi, la peinture de Laubiès, depuis ses origines, ou presque, apparaît-elle hors du temps, hors des perturbations, des modes, décidemment étrangère aux courants et aux ressacs de l’histoire, immémoriale. Dire ce qu’elle est se révèle entreprise délicate tant elle semble échapper aux normes habituelles de l’analyse même si s’imposent d’évidence non ses refus – qui seraient encore manière de participer – mais ses retraits.
Dès son commencement, tel que nous le connaissons, l’œuvre marque déjà cette distance : pas d’images, pas des gestes, pas de matières épaisses, rien de ce par quoi s’affirmait alors la peinture en ce début des années 1950. Les traces qui habitent ces œuvres semblent bien plus signes en voie d’effacement, écritures subsistantes d’un langage en perdition que gestes décisifs que perçoit mieux l’intuition émue du spectateur sensible que la science du lettré.
L’effusion, maître mot de l’œuvre de René Laubiès, n’est certes pas de nos jours une quête communément partagée. Elle ne l’était pas même quand Laubiès commença de peindre. Quelle obstination pour se contenter de la flûte ou du triangle face à l’éclat des cuivres, au déferlement des timbales! Mais quelle certitude aussi qui rend en fait éclatante (et en fait immodeste) la trop évidente humilité des œuvres.
Ce que les peintres modernes, depuis la lumière triomphante des impressionnistes jusqu’au monde sans objet de l’art abstrait, nous avaient offert, c’était une célébration du réel, jusque dans sa disparition. Laubiès, comme quelques autres rares peintres de sa génération, nous propose de contempler, image lumineuse au fond de la chambre obscure de la peinture, non les choses, ni même leur ombre portée mais un éblouissement intérieur, la concrétion de l’émotion dans le regard du peintre.
On sait Laubiès peintre voyageur ; on sait que ses œuvres ne sont pas réalisées à Paris, mais au fil des années en Grèce, en Inde, en Turquie… Rien pourtant d’un journal de voyage dans ces peintures. Subtil qui pourrait dire, hormis un cachet apposé, que tel tableau provient d’Iran, tel autre des Iles de la Sonde. C’est que le spectacle du monde est moins pour Laubiès l’objet de la peinture que le point initial d’une profonde méditation, l’origine d’une communion que les tableaux matérialisent. Semblables aux Pierres des rêve qui suggèrent à partir de l’indéfini de leurs marbrures un paysage que chacun formalise au gré de son regard, les œuvres de Laubiès sont le support de la rêverie du spectateur, un appel à partager l’infini de la peinture.
Car aussi délicatement raffinés qu’apparaissent ces tableaux, c’est une œuvre en suspens que proposent ces papiers où la composition se masse, corps aérien au centre de l’œuvre, dans un mode similaire à celui par lequel Fautrier détachait le sujet de la toile, c’est l’espace même: une densité atmosphérique différente (aussi étrangère aux peintres dits «nuagistes» qu’aux objets de Fautrier) née d’une intensité différente de la couleur, d’une coagulation de la matière picturale pourtant parcimonieusement étalée, puis raclée au moyen d’une lame de rasoir.
Comment de ces pigments secs, sans qualité particulière, naît la lumière reste le mystère de la peinture de Laubiès. Comment de ces traces presque identiques, répétées d’une œuvre à l’autre au moyen de gestes simples, apparemment semblables, surgit toute la diversité du monde, rendant chaque tableau différent, inoubliable justement par ce peu qui le fait singulier, c’est ce que cette peinture s’efforce d’explorer depuis un demi-siècle.
«Plus le quoi va de soi, et plus on sera attentif au comment», expliquait Stockhausen à propos de Hymnen. C’est aussi de ce quoi évident que part l’œuvre de Laubiès. Nulle volonté de nous donner une nouvelle version de l’image du monde, aussi momentanément définitive que celles offertes par les visionnaires de l’art moderne, mais un souci contraire d’infini – dans le double sens de ce terme – tant pour s’effacer, courtoisie suprême, devant le visiteur de sa peinture, lui laissant ainsi la chance d’y apporter son émotion, sa connaissance et son rêve que pour ouvrir le tableau, quelque soit la taille de celui-ci, à tous les souffles du monde.
Gaëlle Rageot-Deshayes, Directrice du Musée d’art moderne et contemporain des Sables d’Olonne, 2019